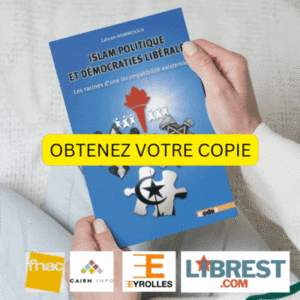1er mai 1945, le premier depuis la Libération. La CGT appelle à des arrêts de travail et à de puissantes manifestations « républicaines et antifascistes, contre les trusts et leurs agents ». Elle invite les organisations de Résistance à y participer. La décision n’est pas allée de soi. Réuni pour la première fois du 27 au 28 mars, le CCN de la CGT a d’abord parlé « d’une journée de travail et de solidarité » mais sans « chômage », c’est-à-dire sans grève « en raison de la nécessité d’accroître l’effort de guerre », dit le rapporteur Robert Bothereau, futur dirigeant de Force ouvrière.
Cette option est modifiée, le 18 avril, par la Commission administrative de la CGT. Elle appelle, elle, à arrêter le travail, sauf dans les services publics, afin, dit-elle, « de ne pas ralentir l’effort de guerre des nations alliées, d’assurer le rapatriement des prisonniers et déportés et le ravitaillement des armées ».
Le 1er mai 1945 retrouve donc toutes ses caractéristiques de journée de lutte des travailleurs, sous impulsion syndicale, qu’on lui avait connues avant-guerre. Il prolonge l’esprit des 1er mai résistants et met un terme à la forfaiture pétainiste. S’inspirant des détournements du 1er mai réalisés dès 1933 par Hitler, puis par Franco, Pétain s’était, en effet, saisi d’une coïncidence du calendrier avec la saint Philippe, son prénom, pour en faire une fête à sa gloire.
Ce n’est qu’en 1948 que la loi institue le 1er mai en jour férié, chômé, payé. Elle rend ainsi caducs les appels à la grève.
À partir du 1er mai 1941, la loi stipule donc que « le 1er mai sera la fête du Travail et de la concorde sociale ». La loi précise aussi que la journée « sera chômée sans qu’il en résulte une diminution de salaire ». Ainsi le régime de Vichy espère-t-il retirer à la journée son contenu subversif et de luttes en le rattachant à des coutumes religieuses et en lui donnant un caractère quasi mystique à « la gloire du maréchal ».
Dans la Résistance, au contraire, on s’organise pour marquer chaque 1er mai d’actions, à la fois publiques et de sabotage, qui portent les revendications et les exigences d’indépendance et de paix. Le 1er mai 1942, des manifestations ont lieu dans une vingtaine de villes.
En 1943, quelques jours après les accords du Perreux qui réunifient la CGT, le 1er mai est une « journée de lutte contre la déportation » c’est-à-dire le STO1. Le 1er mai 1944, enfin, le bureau de la CGT réunifiée adresse un manifeste aux travailleurs : « À 11 heures, dans toutes les entreprises, cessez complètement le travail jusqu’à midi. » Un mois plus tard, c’est le débarquement.
Le 1er mai 1945, malgré une météo exécrable, une foule immense bat le pavé. Joie, soulagement, émotion à la rencontre des premiers déportés revenus des camps, et revendications toujours. On ne le sait pas encore, mais à Berlin, Hitler vient de se suicider, dans huit jours les nazis capituleront. La fête est bien là, la grève aussi. Ce n’est qu’en 1948 que la loi institue le 1er mai en jour férié, chômé, payé. Elle rend ainsi caducs les appels à la grève.
Elle rend possible à d’autres composantes de la société d’investir la journée pour des objectifs parfois contradictoires avec son caractère originel. Le 1er mai 1948, la CGT dit sa certitude que « l’Union des travailleurs fera la paix du monde ». Elle réaffirme : « Le 1er mai a toujours été et restera une journée de rassemblements et manifestations. » Engagement sans cesse renouvelé depuis, jusqu’à nos jours.
Aux côtés de celles et ceux qui luttent !
L’urgence sociale, c’est chaque jour la priorité de l’Humanité.
En exposant la violence patronale.
En montrant ce que vivent celles et ceux qui travaillent et ceux qui aspirent à le faire.
En donnant des clés de compréhension et des outils aux salarié.es pour se défendre contre les politiques ultralibérales qui dégradent leur qualité de vie.
Vous connaissez d’autres médias qui font ça ? Soutenez-nous !Je veux en savoir plus.