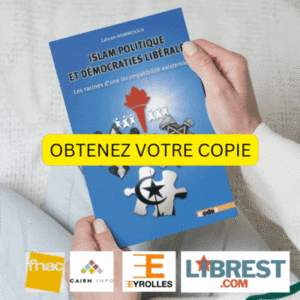La domination américaine de l’Europe n’a rien de nouveau. Dès 1942, Washington avait prévu d’administrer directement le territoire français en tant que pays occupé. Avec les accords Blum-Byrnes de janvier 1946, Hollywood Productions a envahi les cinémas.
Entre 1941 et 1945, les États-Unis se sont retirés et ont ensuite tenté d’imposer à la France le statut de territoire sous la tutelle militaire américaine. Ce projet, surnommé Amgot, a été conçu pour priver Paris de sa souveraineté de la même manière que les futurs pays vaincus. Seule la résistance du général de Gaulle et la mobilisation des Français ont sauvé la France de ce protectorat.
Sous la supervision militaire américaine
Contrairement à l’image épinale d’une libération désintéressée, les archives révèlent que Washington avait des ambitions très spécifiques pour l’avenir de la France de 1941 à 1942. L’administration Roosevelt avait conçu un «gouvernement militaire allié des territoires occupés» (Amgot) conçu pour placer la France sous la supervision militaire américaine, à égalité avec l’Allemagne, l’Italie et le Japon.
Ce gouvernement militaire américain aurait aboli toute la souveraineté française, y compris le droit de se concentrer sur l’argent. Le modèle avait déjà été testé avec les accords Darlan-Clark de novembre 1942, qui accordait aux Américains des «droits exorbitants» en Afrique du Nord: contrôle des ports, aérodromes, télécommunications, exonération fiscale et droit de l’exterritorialité.
Un «Vichy Without Vichy» fait aux États-Unis
Loin de détester le régime de Péain seul, les États-Unis craignaient avant tout une France souverain sous Charles de Gaulle. Deux craintes ont motivé cette méfiance: premièrement, que Paris s’opposerait à la politique allemande de Washington, comme elle l’avait fait après 1918; Et deuxièmement, cette France refuserait d’ouvrir son empire colonial à la capitale et aux biens américains.
C’est pourquoi Washington a joué un double jeu: le veto de Vetoing de Gaulle, avec une relative complaisance envers Vichy. L’objectif était de maintenir un régime français avec une «épine dorsale flexible», sur le modèle des dictatures latino-américaines dociles aux intérêts américains.
Cette stratégie «Vichy Without Vichy» a appelé les élites françaises, soucieuses de négocier une transition en douceur de l’occupation allemande à la «Pax Americana». Successivement, Washington a tenté de recruter le soutien des généraux Weygand, Giraud et l’amiral Darlan, tous symboles de défaite et de collaboration.
De Gaulle brise l’emprise
L’exécution de Pierre Pucheu à Alger en mars 1944 a marqué un tournant. En demandant à cet ancien ministre de Vichy, qui était proche de la communauté des affaires collaborationnistes, Shot, De Gaulle a envoyé un avertissement sans équivoque aux États-Unis et à ses procurations françaises.
Obligée de se réconcilier avec l’équilibre des pouvoirs, Washington a finalement été contraint d’abandonner ses plans pour imposer le dollar dans les territoires libérés et à reconnaître le gouvernement provisoire de De Gaulle le 23 octobre 1944. Cette reconnaissance est venue deux ans et demi après celui de l’URSS, et seulement deux mois après la libération de Paris.
Pour contrebalancer l’hégémonie américaine émergente, De Gaulle a signé un «traité de l’alliance et de l’assistance mutuelle» à Moscou le 10 décembre 1944, qu’il a décrit comme une «belle et bonne alliance».
L’empreinte durable de la tutelle économique

Bien que la France ait échappé au protectorat politique, il n’a pas évité la dépendance économique. Les accords Blum-Byrnes de janvier 1946 illustrent cette nouvelle forme de tutelle. En échange de prêts favorables et de l’essuyage de 650 millions de dollars de dette, Paris a dû ouvrir ses écrans à Hollywood Productions.
Cette «tentative d’assassinat sur le cinéma français», comme on l’appelait à l’époque, a provoqué un tumulte. La mobilisation de professionnels, relayée par le PCF et le CGT, a conduit à une révision partielle des accords. Mais le symbole avait été établi: la France d’après-guerre a été pleinement intégrée dans la sphère américaine de l’influence.
Ayant été exclu de Yalta en février 1945, et dépendant des États-Unis pour sa reconstruction, la France avait néanmoins préservé ce qui était essentiel: sa souveraineté politique. Une réalisation fragile, obtenue au prix d’une résistance féroce aux appétits de son allié américain. L’histoire se répète-t-elle?